Johannes
Steenstrup, "Dissertation sur la Complainte de
Guillaume Longue-Épée et les critiques
dont elle a été l'objet," in Étude sur la vie
et la mort de Guillaume Longue-épée, duc de
Normandie, by Jules Lair (Paris: Picard,
1893), 71-77.
— 71 —
I. — OBSERVATIONS DE M. GUSTAVE
STORM.
Gustave Storm, Kritiske bidrag til
Vikingetidiens historie. 1878 — (P. 140). Au
troisième quatrain, il faut remplacer les mots: sui
rexerunt, qui ne s'adaptent pas ai mètre par
surrexerunt, belliquosæ (femmes
bellqueuses!) par bellicosi (hommes
belliqueux) et quo par quos,
régime (p. 141) direct de subjugavit; le
sens des deux stances est donc: «Il était né au pays
d'aoutre-mer, fils d'un père païen
et d'une mère chrétienne, et il fût
baptisé jeune; après la mort de son père païen, les
guerriers se soulevèrent contre lui, mais il les
vainquit de sa forte droite, se fiant à Dieu.» Ce
témoignage d'un auteur contemporain et intéressé, on
ne peut le rejeter sans de bonnes raisons. Guillaume
était donc né au pays d'outre-mer. Comme
Guillaume fut présenté au roi Charles en 927, on
suppose, en général, qu'il venait d'atteindre sa
majorité; sa naissance aurait donc eu lieu vers 906.
Cependant, il est possible qu'il soit né plus tôt;
ce qui est certain, c'est seulement qu'il était né
avant 911. D'autre part, il ne pouvait pas être de
beaucoup plus âgé, puisque son fils unique, Richard,
ne naquit pas avant 930 environ. En général, dans
les écrits français du Xe et du XIe
siècle, l'expression orbis transmarinus
(pays d'outre-mer), signifie les Iles Britanniques.
Quand le roi Louis arriva d'Angleterre (en 936), on
dit qu'il venait des transmarinæ
— 72 —
regiones ou des transmarinæ partes
et les pèlerins britanniques, à Rome (anglais et
irlandais) sont appelés transmarini. Par
conséquent, avant son installation en France, le
père de Guillaume, Rollon, a fait son séjour de
quelque point des Iles Britanniques, vers l'an 900,
ou peu de temps avant. Il est dit ensuite que son
père était païen, sa mère chrétienne, (sonsignata
alma fide); Rollo a donc épousé, pendant son
séjour aux Iles Britanniques, où il a enlevé, dans
une expédition de Viking, une femme chrétienne,
d'outre-mer, et il a eu, à cet endroit, des enfants
d'elle. Nous verrons plus tard comment cela
s'accorde avec les traditions scandinaves, tandis
que celà est simplement contraire à Dudon qui dit
que Rollon, pendant le siège de Paris (885-887) a
conquis Bayeux et qu'il a enlevé de là une femme de
qualité, «Popa», de laquelle il a eu, à Rouen, son
fils Guillaume.
Il y a encore un reseignement que l'on peut tirer
de la Complainte. Elle dit que Rollon «était
infidèle», non seulement pendant son (p. 142) séjour
d'outre-mer, mais qu'il resta infidèle jusqu'à sa
mort (moriente infidele suo patre).
(P. 141). C'est pourqui l'éditeur de la Complainte,
M. Lair, a remplacé très ingénieusement, Hic in
orbe, par hac in urbe; le
témoignage de la complainte, divergeant de celui de
Dudon, vient par là infirmer le récit de Dudon. Je
n'ai pas besoin de montrer à quel degré un tel
procédé est inadmissible au point de vue critique.
(P. 142). A ce point, M. Lair, a remplacé infidele
par infideles, (sujet de surrexerunt)
pour échapper à la divergence entre la Complainte et
Dudon.
Au premier coup d'œil, cela semblerait (p. 142)
contraire au fait réel que les Normands et leurs
chefs aussi furent baptisés en 912; mais, dans la
bouche du poète ecclésiastique, cela veut dire, sans
doute, que Rollon persistait, malgré son baptême, à
croire aux idoles (et peut-être à les adorer aussi)
et, comme nous allons le prouver tout à l'heure, il
s'est maintenu aussi plus tard en France une
tradition que Rollon faisait des sacrifices à ses
dieux, même après son baptême. Un tel état
intermédiaire entre le christianisme et le paganisme
semble tout naturel; il est d'acrod avec des
rensiegnements venant d'autre part, du contemporain
de Rollon, Helge le Maigre; il est dit qu'il adorait
et le Chirst et Thor.
Le poème français porte donc un témoignage
irrécusable que Rollon séjournait encore au
pays d'outre-mer peu d'années avant 911, qu'il eut
un fils (Guillaume) d'une femme chrétienne, et que
dans son cœur il resta païen, même après son
baptême, jusqu'à sa mort.
— 73 —
II. — REMARQUES DE M. JOHANNES
STEENSTRUP SUR LES NOTES DE M. STORM.
Mon savant confrère de Christiana soutient, pour le
troisième quatrain, qu'il faut remplacer les mots sui
rexerunt par surrexerunt, belliquosæ
par bellicosi, quo par quos.
Voilà trois corrections en quatre vers, mais petu-il
donc se faire que le second quatrain puisse se
passer entièrement de corrections?
Faut-il bien lire: hic in orbe transmarino
natus patre, c'est-à-dire une indication
absolument contraire aux déclarations bien connues
de toutes les sources, que Guillaume était né en
Normandie — ou ne doit-on pas lire plutôt, comme l'a
proposé M. Lair: hac in urbe.
M. Storm maintient que la correction est
«inadmissable au point de vue critique». Pourtant,
il me semble que le devoire critique ne peut imposer
au savant un respect absolu pour les lettres qui se
trouvent dans le manuscrit en question, puisqu'il
lui faut absolument corriger beaucoup de passages
dans ce petit poème, où il y a surtout force
abréviations incorrectement résolues.
On peut, d'ailleurs, alléguer de vonnes raisons qui
renent nécessaire cette correction.
1 — Premièrement, la langue poétique porte à croire
— lors même que les exigences ne sont pas plus
grandes que celles que nous impose ce poème-ci — que
la strophe ne doit pas commencer par le mot
choquant, hic; par le même raison, les
mots régis: orbe transmarino, qui suivent
immédiatement la préposition, semblent un peu bien
prosaïques. Autrement dit, une tournure de phrase
telle que la suivante: transmarino hic in orbe
natus patre, serait plus poétique; meilleure
encore serait la tournure que voici: hoc in
orbe (ou hac in urbe) transmarino
natus patre.
De plus, il sonnerait mieux, sans doute, si le mot
«patre» ne se trouvait pas seul au premier
vers et qu'on eût cette place un adjectif aussi,
c'est-dire: transmarino patre. Enfin, au
commencement de la cinquième strophe du manuscrit: Hic
audito olim regem Hludovicum, il est
absolument nécessaire de remplacer hic par
hoc; — pourquoi donc s'affliger de
remplacer hic par hac dans le
seconde stance? Et, s'il paraissait un contraste et
qu'au même vers on lût: «Lui, il était originaire de
ce pays, mais son père était un étranger», le
passage se trouverait meveille.
— 74 —
2 — En considération du récit du poème, parce qu'il
manque d'une indication des localités où se passe
l'action, on y lit: «Il était né dans un pays
d'outre-mer d'un père qui persistait à adhérer au
paganisme et d'une mère chrétienne, mais il fut
baptisé lui-même.» Tout-à-coup le récit change comme
voici: «Quand mourut son père, les guerriers se
soulevèrent contre lui.» Mais cette révolte se passa
en Normandie, et nous n'avons pas point appris que
le père, qui avait engendré le fils dans un pays
étranger et qui restait païen, soit venu en
Normandie.
3 — Que le terme des transmarini soit
employé bien souvent par les Français en parlant des
Anglais et vice versa — cela est hors de
doute; mais on trouve aussi que ce terme est employé
en Angleterre et en France en parlant des peuples
scandinaves (1).
4 — Raisons historiques. — Naturellement,
M. Storm est en droit de maintenir qu'il ne faut pas
expliquer le poème selon les autres sources; qu'au
contraire, il faut le regarder comme une source
isolée, et à l'aide du poème chercher à trouver la
vérité. Ces observations d'un historien distingué
son justes, et j'ai tâché d'apprécier les mots leur
juste valeur. Mais cela fait, on a lieu aussi de
considérer les récits des autres sources. Car nous
devons nous rappeler qu'il ne faut guère avoir peur
de faire des corrections dans ce poème, où il y a
des stances qu'on doit modifier à peu près
entièrement.
Voici donc la question que nous nous adressons. Les
autres renseignements historiques concordaent-ils
avec la leçon: in orbe transmarino natus?
Les sources historiques disent-elles que Guillaume
naquit hors de la Normandie?
La Chornologie. L'année de la naissance de
Guillaume est inconnue; on ne peut le deviner que
par ricochet. En 927, il est associé à son père, où
il gouverne de sa part; en même temps, il prête
serment Charles le Simple. Sans doute, on n'aurait
pas confié le pays neuf un enfant ou même un homme
très jeune; il est donc probable qu'à cette époque,
Guillaume avait au moins une vingtaine d'années.
Vraisemblablement, it n'était pas plus âgé non plus
(V. Dudon, p. 181).
M. Lair suppose (p. 179) qu'il avait vingt et un
ans; il est donc né vers 905 ou 906. Est-il
— 75 —
maintenant probable que Rollon ait fait son séjour
aux Iles Britanniques cette époque, cinq ou six ans
seulement avant que le roi de France cédât la
province par suite d'une longue série de guerres?
Il n'y a guère de probabilité qu'un chef récemment
arrivé ait obtenu les advantages d'une cession de
territoire, arrachée ici pour la première fois à la
France. A cause des difficultés de la chronologie,
M. Storm s'efforce rendre Guillaume plus âgé. Avant
son installation en France, le père de Guillaume,
Rollon, a fait son séjour quelque part dans les Iles
Britanniques, vers l'an 900 ou peu de temps avant.
La mère. En ce lieu, dit M. Storm, Rollon
a épousé (ou a eu des rapports avec) une femme
chrétienne. Mais n'y a-t-il aucune source, soit
française, soit scandinave qui dise que Rollon a été
marié en Écosse? Il faut répondre: Non, pas une
seule! Le fait sur lequel s'appuie M. Storm (p. 174)
est le reseignement isolé du Landnamabók
que Helge, fils d'Ottar, en dévastant l'Écosse vers
934-940, fit prisonnière Nidbjorg, fille de la fille
de «Gangerrolf» (s: Rollon), Kadlin et du roi
Bjolan. M. Storm indique que ce Bjolan — comme le
dit aussi M. Skene (2) — a dû
être un de ces chefs, nommés O'Beolan, desquels
descendent, suivant la tradition écossaise, les
comtes d'Appelcros (partie du sud de Ross).
Nous sommes ici au beau milieu des traditions d'une
époque beaucoup postérieure, et les chefs écossais
n'était quère des «rois»; mais toutefois, la
conjecture est admissible et il es possible que
Bjolan ait vécu à Ross.
Quant à la valeur du reseingements islandais, je ne
le discuterai pas de plu près, je ferai seulement
remarquer qu'il paraît ici dans une table
généalogique, non pas dans quelque narration des
exploits de Rollon.
Du Landnamabók, dit M. Storm (p. 174), le
récit a passé dans le Flateyjarbók (I, p.
308) et dans la Laxdælasaga (chap. xxxii),
où Bjolan n'est pas mentionné, du reste. Je suis
complètement d'accord sur le premier point, le Flateyjarbók
copie seulement le Landnama; mais l'égard
de la Laxdæla, il en est autrement. Dans
une exposition généalogique il est dit d'un certain
Osvif que sa mère s'appelait «Nidbjorg», la mère de
celle-ci «Kadlin», fille de «Gangerrolf», fils
d'Oxnethorer; il était un noble chef à Viken, et
était appelé ainsi (Oxnebœufs), parce qu'il
possédait trois îles et quatre-vingts bœufs dans
chacune (3). Outre que Bjolan
n'est pas mentionné, l'attention est détournée
entièrement de «Gangerrolf» qui est mentionné
seulement en qualité de fils d'Oxnethorer, résident
à Viken (à Christianiafjord), loin du sol natal de
Ragnvald et de son fils, Rollon (suivant la
tradition
— 76 —
des Sagas) à Mœre (à Throndhjemsfjord);
d'Oxenthorer, la saga fait un long récit et quant au
célèbre Gangerrolf, elle le laisse passer sans mot
dire!
En tout case, il résulte de cet état de choses que
le reseignement ne peut être d'une très haute
valeur. Mais soit! Une fille, légitime ou illégitime
de Gangerrolf, fils du comte de Mœre, appelée du nom
chrétien de Catherine, a été marié en Écosse, et il
en suite — c'est la conclusion de M. Storm (p. 175)
— que Gangerrolf a été marié (ou a eu des rapports)
avec une femme chrétienne aux Iles Britanniques.
Mais parce qu'une femme est mariée quelque part, il
n'est pas incontestable qu'elle y soit née ou que
son père y a fait son séjour autrefois. Par exemple,
Kadlin a pu être aussi bien une fille du conquérant
de la Normandie et d'une femme française, née en
France, quoiqu'elle fût mariée plus tard en Écosse.
Du reste, il est singulier que la petite=fille du
duc de Normandie soit enlevée simplement par un
Islandias et que les enfants de Nidbjorg, qui
émigrent plus tard d'Islande, n'aillent pas à leurs
parents puissants de Normandie, mais, au contraire,
en Norvège.
Supposons cependent qu'il y ait en effet une
tradition islandaise qui porte à croire que
Guillaume est le fruit des rapports de Rollon avec
une femme chrétienne, aux Iles Britanniques.
Comme contrate à cette tradition, fixée sur le
parchemin au plus tôt au XIIe ou XIIIe
siècle, on trouve la tradition des conquérants de
Normandie, écrite vers l'an 1000, et plus tard aussi
pendent le XIe siècle, que Rollon avait
épousé une fille du comte Bérenger de Bayeux, nommée
Popa, et qu'il eut d'elle son fils Guillaume et sa
fille Gerloc. Dudon, écrivant sur la demande du
petit-fils de Guillaume, le sait; Guillaume de
Jumièges raconte le même fait. C'est pourquoi on
crorait que, si aucune tradition ce ces temps-là
pouvait être bien confirmée, ce devait être
celle-ci. La famille ducale devait savoir qui était
la femme du père de la race.
Ce serait un peu étrange, si la tradition
scandinave, — soit islandaise, soit norvégienne, —
fondée sur une base si faible, devait être préférée
la tradition française.
Il y a une source à quelle M. Storm attache une
grande importance pour l'histoire de Rollon, c'est
la «Historia Norvegiæ», rédigée vers 1180
(c'est l'opinion de M. Storm) ou au XIIIe
siècle (suivant d'autres savants). Mais qu'est-ce
donc que l'on y trouve? «Ast idem Rodulfus regni
primatu potitus defuncti comitis uxorem duxit ex
qua genuit Willelmum». Tandis que tout ce que
dit cette chronique, au sujet de l'histoire de
Rollon, est regardé par M. Storm comme «une
tradition populaire de bon aloi (p. 173), une
tradition norvégienne» (p. 170, il juge le passage
susdit sans valeur. Bien entendu, on ne peut que
s'étonner que la même source qui donne — suivant
l'assertion de M. Storm — la bonne tradition
norvégienne de l'histoire antérieure de Rollon, non
seulement ne connaisse
— 77 —
pas la tradition norvégienne de l'épouse de Rollon,
mais encore avance cette nouvelle fausse, bien
apparentée à la tradition française, qu'elle était
«la femme du comte précédent.»
Guilaume de Jumièges même, chez lequel M. Storm
prétend quelquefois trouver une protestation contre
le récit de Dudon (p. 160 et suiv.), raconte que la
mère de Guillaume s'appelait Popa, fille de Bérenger
et était native de Bayeux; il connaît jusqu'au nom
de la sœur de Guillaume (Gerloc) qui naquit de la
même mère et qui se maria à Guillaume de Poitou
après l'avènement de Guillaume Longue-Épée,
c'est-à-dire justement à l'époque où la sœur
supposée de Guillaume — en Écosse, — mariaitsa fille
(Storm, p. 174; M. Steenstrup, II, p. 378).
Enfin, selon toute probabilité, c'est justement à
Rouen que Guillaume est né. La ville fut plus tard
la résidence du duc, et le récit de Dudon (p. 179)
n'est, en effet, qu'une paraphrase de ce que dit le
poème en vers: Patre Daco scilicet Rollone,
matre Francigena vid. Poppa..... genitus,
Rotomagensi urbe extitit (comme l'a fait
remarquer aussi M. Lair, p. 396).
Voilà la raison décisive, ce me semble, pour
remplacer «orbe» par «urbe», car
en soi, rien n'empêchait d'employer le mot d'«orbis»
pour dire «province».
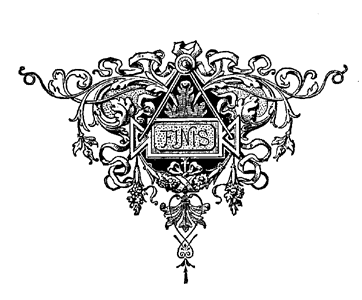
NOTES
(1) Guillaume de Malmesbury, Gesta
Pontificum, l. IV, §154, en parlant de la
ville de Bristol: «portus navium ab Hibernia et
Norregia et ceteris transmarinis terris venientium
receptaculum. — Ailred de Rivaux: Omnes
per Angliam Dacos..... Edelredeus jussit
interfeci. Quod Daci transmarini audientes....
duce Suano cum innumerabili exercitu Angliam
intrantes, etc. (Twysden. Scriptores
decem 362). — Flodoard, 944. Normanni
qui nuper a transmarinis advenerant regionibus
(Pertz, Scriptores, III, p. 391). — Anselmi
Gesta episcoporum Leodiensium: legimus
diram Nortmannorum gentem cum duce suo
crudelissimo Godefrido a transmarinis partibus
nostros fines irrupisse. (Pertz, Scriptores,
VII, p. 199). — Cartulaire de Saint-Père de Chartres
(vetus aganon) 5: Quadam vero
tempestate, de transmarinis partibus cum rostratis
navibus gens pagana ebulliens... totam pene
Neustriam crudeliter devastabat, 15: Monasterium
solo tenus transmarinis dirutum, 45: Paganis
transmarini.... pene totam Europam flammis atque
prædis ferroqùe crudeli depopulando vastaverunt.
46: transmarini pagani, quibus dux præerat
Rollo, mare transmeantes in Neustria partibus.....
septem civitates obtinuerant.
(2) Skene. Highlanders of
Scotland, II, p. 222.
(3) Laxdæla, édition
de Kaalund, p. 106, chap. xxxii.